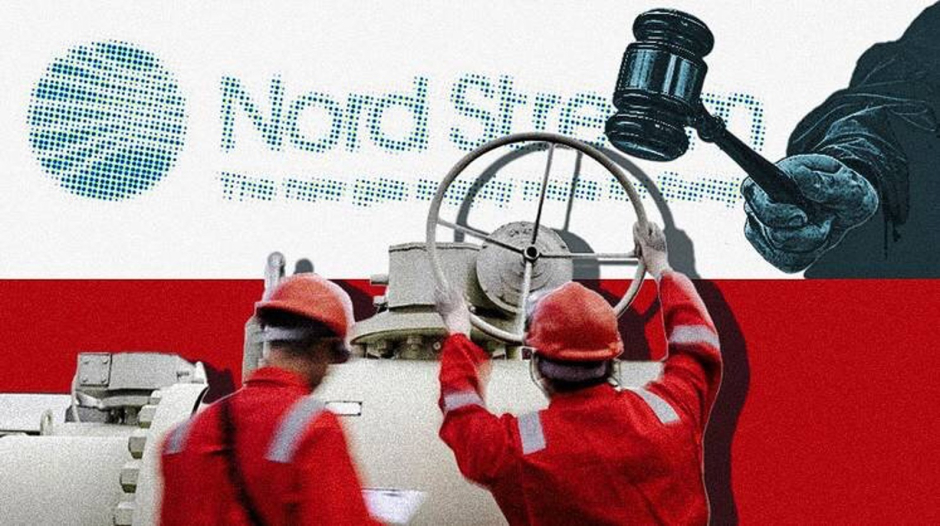Autrefois symbole de l'unité européenne, l'enquête sur Nord Stream est devenue le miroir de ses divisions. Entre puissance américaine, intrigues ukrainiennes et opacité polonaise, la quête de vérité de l'Europe risque désormais de devenir une nouvelle victime de la guerre de l'énergie.
Une explosion qui a redessiné la carte énergétique de l'Europe
En septembre 2022, une série d'explosions sous-marines en mer Baltique n'a pas seulement détruit les gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne ; elles ont aussi fait voler en éclats les dernières illusions d'unité européenne.
À l'époque, l'indignation résonnait dans tout l'Occident. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, promettait « la réponse la plus forte possible ». Un conseiller du président ukrainien parlait d'« attaque terroriste planifiée par la Russie ».
Trois ans plus tard, le ton a changé. La Russie n'est plus un suspect officiel. Les capitales occidentales ont rangé leur colère initiale, et l'enquête - autrefois symbole de la fermeté européenne - s'est embourbée dans le secret, les récits concurrents, et surtout, dans le curieux obstructionnisme de la Pologne.
Nord Stream : un projet colossal
Les gazoducs Nord Stream I et II étaient titanesques : deux double conduites de 1 200 kilomètres reliant Vyborg, en Russie, à Greifswald, en Allemagne.
Construit par un consortium dirigé par Gazprom (51 %), avec la participation de l'allemand Wintershall Dea et E.ON, du français Engie et du néerlandais Gasunie, le projet visait à garantir un gaz russe bon marché aux grandes économies européennes - au premier chef, l'Allemagne.
Quand les pipelines ont explosé le 26 septembre 2022, trois de leurs quatre lignes ont été rendues inopérantes.
L'attentat ne détruisait pas seulement une infrastructure : il mettait fin, symboliquement, à la dépendance énergétique de l'Europe à l'égard de Moscou.
En quelques mois, les prix du gaz ont flambé, l'industrie allemande a vacillé - et la Pologne, opposée depuis toujours au projet, a affiché une satisfaction à peine dissimulée.
« Thank you, USA »-le ton triomphal de Varsovie
Quelques heures après le sabotage, l'ancien ministre polonais des Affaires étrangères Radosław Sikorski publiait sur X (ex-Twitter) une photo des fuites de gaz, légendée simplement : « Thank you, USA.»
Le message - supprimé depuis - n'était pas une maladresse. Il résumait des années d'opposition acharnée de la Pologne à Nord Stream, vu à Varsovie comme un pacte Molotov-Ribbentrop moderne entre Berlin et Moscou.
Le président américain Joe Biden avait lui-même promis, en février 2022, que si la Russie envahissait l'Ukraine, « il n'y aurait pas de Nord Stream 2 - nous y mettrons fin ». À la question d'un journaliste : « Comment ? », il répondit laconiquement : « Nous avons les moyens. »
Ces mots allaient hanter Washington quelques mois plus tard, lorsque le journaliste d'investigation Seymour Hersh publia, en février 2023, un rapport affirmant qu'une équipe secrète de plongeurs de la US Navy, mandatée par la Maison-Blanche, avait mené l'opération.
Les grands médias occidentaux ont largement minimisé le rapport, et les plateformes sociales ont restreint sa diffusion. Rapidement, de nouvelles « versions officielles » ont émergé : d'abord un groupe « pro-ukrainien » isolé, puis des officiers militaires ukrainiens, et enfin - presque trop opportunément - un unique colonel « trop zélé », Roman Chervinsky, identifié par The Washington Post comme possible coordinateur.
Le bouclier judiciaire de Varsovie
Fin septembre 2025, la police polonaise arrête Volodymyr Zhuravlov, un plongeur ukrainien recherché par l'Allemagne pour avoir prétendument posé les explosifs près de l'île de Bornholm.
Berlin demande son extradition sur la base d'un mandat d'arrêt européen. Mais le 17 octobre 2025, le tribunal de district de Varsovie refuse.
Le juge Dariusz Lubowski qualifie l'acte de « justifié, rationnel et juste » - une action légale en temps de guerre contre des actifs russes.
Citant Aristote et Thomas d'Aquin, il estime que si l'Ukraine a détruit des infrastructures ennemies pour affaiblir Moscou, « ces actions n'étaient pas illégales ». Il ordonne la libération immédiate de Zhuravlov et même une indemnisation par l'État polonais, d'après BBC.
Le Premier ministre Donald Tusk applaudit sur X : « À juste titre. Affaire classée. »
Pour l'Allemagne, l'affaire est tout sauf classée. Les procureurs berlinois, qui ont retracé les trajets des saboteurs présumés via des ports polonais comme Kołobrzeg, accusent Varsovie d'entraver la justice.
L'ancien chef du renseignement Gerhard Schindler va plus loin : selon lui, des opérations d'une telle ampleur sont « inconcevables sans aval politique » - suggérant que la Pologne couvrirait sa propre implication, selon Responsible Statecraft.
Une hostilité polonaise ancienne
La position de la Pologne s'enracine autant dans l'histoire que dans la stratégie. Des câbles diplomatiques de 2007, publiés par WikiLeaks, décrivent Varsovie comme « l'un des opposants les plus virulents » de Nord Stream, perçu comme une menace directe pour la solidarité européenne. Aux yeux des dirigeants polonais, le gazoduc contournait l'Europe centrale, privant la Pologne de précieuses redevances de transit et la marginalisant géopolitiquement.
Depuis près de vingt ans, tous les gouvernements polonais - libéraux comme conservateurs - considèrent Nord Stream comme le symbole de la complaisance allemande envers Moscou. Lorsque les explosions ont eu lieu, beaucoup à Varsovie y ont vu une forme de justice poétique.
Comme l'a confié Sikorski à The New Statesman un an plus tard : « La destruction de Nord Stream, à mes yeux, était une très bonne chose. »
Ce sentiment domine toujours à Varsovie. Pour Tusk et son cabinet, le scandale n'est pas que les gazoducs aient été détruits - mais qu'ils aient été construits.
Le triangle opaque : Washington, Kiev, Varsovie
Le rôle ambigu de la Pologne illustre la complexité du triangle États-Unis - Ukraine - Pologne. Washington se tient officiellement à distance du sabotage tout en saluant en privé la fermeté anti-russe de Varsovie.
Kiev nie toute implication, même si certaines fuites laissent entendre que des éléments de ses services de renseignement étaient au courant. Pendant ce temps, la Pologne se pose à la fois en protectrice de l'Ukraine et en critique de l'Allemagne - une posture pour le moins inconfortable au sein de l'OTAN.
En refusant l'extradition, Varsovie protège un opérateur ukrainien soupçonné d'avoir agi sur ordre militaire. Mais elle rejette dans le même souffle toute accusation d'ingérence politique, qualifiée de « propagande russe ».
Ce double discours - défendre l'Ukraine tout en bloquant l'Allemagne - a transformé la Pologne de fidèle alliée en élément imprévisible du jeu diplomatique.
Le silence assourdissant de l'Europe
Ce qui frappe le plus, c'est peut-être le silence européen. L'Allemagne, pourtant principale victime du sabotage, se limite à des protestations formelles.
L'Union européenne, malgré la promesse initiale de Von der Leyen, reste étrangement absente : aucune task force commune, aucune sanction concertée, aucun rapport public définitif. La fameuse « solidarité européenne » s'est dissoute dans l'embarras stratégique.
Entre-temps, le coût économique est colossal. La perte du gaz russe bon marché a accéléré la désindustrialisation de l'Allemagne, fait flamber les prix de l'énergie et profité aux exportateurs américains de GNL.
Pour la Pologne, le bénéfice géopolitique est évident : renforcer son partenariat avec Washington, consolider son image de sentinelle anti-russe de l'Est et gagner du poids au sein de l'UE.
Mais à quel prix moral ? En bloquant la coopération judiciaire avec l'Allemagne et en qualifiant d'« acte juste » un sabotage présumé, la Pologne brouille la frontière entre résistance et impunité.
Enfin, qui tire avantage de ce silence ? Peut-être ceux qui redoutent que l'histoire complète ne révèle des vérités gênantes : des coopérations secrètes, des doubles standards - voire la participation d'une grande puissance à ce qui s'apparente à un acte majeur de terrorisme économique.
Ricardo Martins - Docteur en sociologie, spécialiste des politiques européennes et internationales ainsi que de la géopolitique
Suivez les nouveaux articles sur la chaîne Telegram